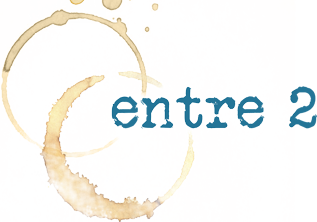Le plus vieux métier du monde à l'agonie
Ce récit n'est ni misérabiliste, ni édulcoré, ni représentatif. Les femmes de la rue ont toute une histoire différente. En revanche, si peu semblables, leurs expériences entaillent profondément certains clichés et s'accordent sur certaines lignes, celles d'un « métier en crise ».
Un reportage de Céline Rase
Retrouvez les témoignages de ces travailleuses en crise et ceux des acteurs de terrain qui les suivent au jour le jour en cliquant sur les boutons roses, au fil de ce récit
Une journée avec Edith
« Je ne suis pas qu'une pute » ; Edith a passé 60 ans. Elle est maman et mamy ; mais toujours elle balade son corps sur les trottoirs du quartier nord. Pour elle, la prostitution de rue, c'est un vrai métier. Elle le raconte. Journée ordinaire d'un quotidien qui l'est moins.
« Entre 2 clichés »
Avec la photographe Mélanie Peduzzi, l'asbl Entre-2 inaugure une exposition sur le travail social dans le milieu de la prostitution. Du 20 septembre au 15 mars 2015, des clichés grand format montrent sans cliché des morceaux de vie des putes de rue. La visite est un parcours libre entre les locaux de l'asbl, une supérette, la Maison de l'Emploi, le café « Le Bridge », le Studio-Europe et le KVS. C'est dans ce mouvement et en collaboration avec cette initiative, à laquelle sont empruntées les photographies, que s'inscrit ce web-documentaire.
+ Expo « Entre 2 Clichés », jusqu'au 15 mars 2015 dans 6 lieux du quartier Alhambra.
Plan et info sur le site d'Entre2 ou sur la page Facebook d'Entre2
7h. « C'est très mal vu d'être une pute »
Edith se réveille dans la région de Namur, loin de son travail. C'est un choix raisonné : « J'ai bien trop peur qu'on me reconnaisse, personne n'est au courant de mon activité », explique-elle. « Ni ma famille, ni mes amis. Il y a une époque où ils l'ont su. Mon gendre a sous-entendu que je ne pourrais plus voir ma fille. « Comment a-t-elle pu tomber si bas », s'étonnait ma meilleure amie. « Ça va lui passer » se disaient-ils tous. Après tant de jugements, je leur ai laissé croire qu'ils avaient raison.
Mais ça ne pouvait pas passer. Pour me redresser financièrement je ne voyais pas d'autres solutions. Quel autre boulot m'aurait mis dans la poche 100 euros par jour ? ».


Sa fille l'a appris quand un client a téléphoné
Sur le trottoir, les filles ne se ressemblent pas et beaucoup sont loin du poncif de la pute aux cuissardes à talons. En baskets - pour arpenter les rues dix heures durant- et gros manteau- pour se protéger du froid, elles se regroupent par essaims linguistiques et peu finalement parlent le français. Beaucoup sont des filles de l'Est. Elsa par exemple a 33 ans et un petit garçon de 6 ans en Albanie. Elle campe un mois sur ce trottoir, le temps de capitaliser si peu et de retourner à sa famille. Pourquoi Bruxelles, elle ne sait pas… Comme elle, la plupart des prostituées sont mamans, mais rarement elles gardent la tutelle de ces enfants nés d'éphémères histoires d'amour. Cette rupture, imposée par le juge ou la distance du pays d'origine, fonctionne comme un traumatisme supplémentaire. Elles tentent de ne rien souffler de leur activité à leurs proches. Elsa hausse les épaules et lance un regard interloqué, c'est comme une évidence, il faut garder le silence. Pour les protéger – et se protéger soi-même – de la déception. Martha regrette comment sa fille l'a appris malgré elle, lorsqu'un client a téléphoné à la maison.
Beaucoup de ces femmes ne sont pas toutes jeunes. Thérèse, que l'on croise, a 59 ans ; sa « consœur »… 71. Il n'est d'ailleurs pas rare que des femmes se posent tardivement sur le marché du sexe tarifé, passé la cinquantaine, une fois refermées les issues du monde de travail.


« Les gamins nous tapent sur les fesses »


En journée, elles sont à peine moins nombreuses qu'en soirée. La prostitution n'est pas un luxe de nuit. Au contraire, beaucoup évitent l'ambiance nocturne qui augmente les risques de violence et de vol. Pour autant, même à la lumière, les prostituées sont très exposées. « En journée, ce sont les gamins qui nous ennuient ; ils nous insultent, nous tapent les fesses, et on ne peut rien contre eux », explique une jeune Roumaine.
Bien que routinière à la manière d'Edith, la prostitution flirte en effet avec une faune violente que ces femmes sont les premières à banaliser. Le plus souvent, la violence est verbale et psychologique ; elle agresse moins sur le trottoir que dans le cercle privé, où conjoints et « loverboys » dominent. Plus qu'ailleurs, les coups partent vite. Souvent sans papiers, les filles ne peuvent pas porter plainte. Ces derniers mois, deux prostituées du bloc du nord sont décédées, l'une poignardée à son domicile à Schaerbeek, l'autre d'une overdose.


Besoin d'être « défoncées » pour y aller
Car la drogue imbibe le milieu dans une relation vicieuse : les filles se prostituent pour payer leur shoot et ont besoin d'être « défoncée » pour se prostituer. Souvent, les clients proposent et allongent. Plus que la drogue, ce sont les antidépresseurs qui se consomment par poignées. Mais la dépendance n'est pas systématique et pas mal de filles parviennent à garder une vie structurée. C'est sans doute le plus déroutant, la faculté de celles qui parviennent à baliser imperméablement vies privée et professionnelle.
« Leur rapport brut aux choses, c'est ce qui me marque le plus », confie Mélanie Peduzzi. Si la plupart ont des vies éclatées, les prostituées, belges en particulier, sont en prise avec le même quotidien que nous. Elles sont en couple voire mariées, ont des enfants, et abandonnent le trottoir en fin de journée comme d'autres quittent leur bureau. Dans leurs cas, la prostitution relève d'un choix qui ne perturbe que parce qu'il contredit les normes généralement admises et les sensibilités les plus courantes. Ces femmes banalisent le sexe là où la société le sacralise. Mais « ce n'est pas parce qu'on travaille avec son corps qu'on ne se respecte pas », précise la photographe. Et de relever que l'inverse est vrai. « Il existe toutes sortes de professions où l'on se corrompt, s'humilie et ne s'estime plus soi-même ». Elles le disent, « ce n'est qu'un métier ».
Sale « comme un homme »
Un métier parfois sale, « comme un homme ». « Plusieurs fois il m'est arrivé de vomir juste à côté d'eux », explique Tania, 45 ans. « Soit qu'ils sont là avec leurs goutes de sueur qui me tombent dessus ; soit qu'ils sont mal lavés et demandent une fellation. Les odeurs sont trop fortes… Quand on les quitte on n'a plus qu'une envie, se glisser dans un bain de détergent ».
8h. « Pour le curé, je peux me prostituer, mais pas voler mes clients »


Au pied du lit d'Edith, un Christ en croix. « Je lui fais coucou en me levant ». Sa foi compose avec ce métier « qui ne fait de mal à personne, au contraire ». Quand elle va à confesse, Edith ne subit pas le discours moraliste de son curé. « Ce qui l'inquiète au fond, c'est de s'assurer que je ne vole pas mes clients. Ça c'est un pêché. Et je ne le commets pas. En revanche, beaucoup de filles font les poches ».
9h. Une navetteuse ordinaire
Edith prend le train, comme des milliers d'autres navetteurs, pour aller travailler à Bruxelles. 1h30 aller, 1h30 retour. Cela lui laisse le temps de se maquiller et de faire du tricot, des bandes et des bandes de couleurs pour des couvertures en laine ensuite offertes à Oxfam. Ou des écharpes pour ses cinq petits-enfants et son arrière-petit-fils. Métro-boulot-dodo. Elle s'étonne qu'on s'étonne de la particularité de son métier.


10h. « C'est comme ça »


Les doigts battant l'aiguille du tricot et le train filant vers Bruxelles, Edith repense à « sa première fois » : « J'avais déjà plus de 50 ans. Un mauvais divorce m'avais acculée financièrement, et mon boulot d'infirmière, même avec ses heures supplémentaires, ne me permettait plus de payer les pensions alimentaires. Alors j'ai passé le cap. Ça n'a pas été si difficile, j'étais habituée à manipuler des corps nus et j'avais déjà fait un mariage de raison. Aujourd'hui c'est devenu mécanique. Une fois qu'on y est, on y est, on n'y pense plus. Ça ne me dégoute pas. Si l'un de mes clients n'est pas propre, je fais mine de passer par la petite salle de bain de la chambre, pour lui suggérer de faire une toilette, quitte à la faire moi-même ».
11h. A l' « Hôtel »
Dans le quartier nord, trois établissements proposent des chambres aux prostituées et leurs clients. Edith choisit le « Studio 2000 » ; elle va y déposer son sac avant de se jeter dans la rue. À peine peut-on apercevoir par la porte entre-ouverte de ce lieu interdit aux journalistes la décoration orientale surchargée et l'accent polonais de la maitresse de maison. Ici, les chambres se louent 25 euros pour deux heures. « Elles sont bien entretenues, la literie est chaque fois changée, et on a de quoi faire sa toilette », explique Edith, qui parle d'ailleurs d' « hôtel ». « Ca n'a pas toujours été si « luxueux » ; près de la gare du midi, les chambres étaient si miteuses que j'avais des morpions. Aujourd'hui, ils ont tout rasé ».


« Les clients qu'on aime bien, c'est la belle vie »
Le mac n'est plus seul maître des trottoirs. Les filles de la rue se pensent plus libres, bien qu'elles soient souvent enlisées dans des rapports de force qui les dépassent. « Il peut arriver qu'on tombe sur des clients qu'on aime bien. Alors c'est la belle vie », raconte l'une d'elle. Pour un temps seulement. Le Dr Herman Van Herck, qui suit les prostituées de la gare du nord tous les mercredis, souligne l'importance et les dangers du nouveau phénomène que constituent ces « loverboys », des hommes sans revenus dont elles s'amourachent. Non seulement, les filles les entretiennent sans comprendre leur assujettissement déguisé, mais surtout, la relation sexuelle est dans ces cas gratuite et non protégée. C'est le règne des MST.


Le rêve du chevalier blanc


En consultation médicale à l' « Entre 2 », le médecin croise la syphilis, la chlamydia et le sida et déplore de voir les prostituées continuer à travailler. Il a pour elles une immense compassion : « Ce sont des femmes impuissantes qui au fond d'elles ont ce rêve du chevalier blanc. Tous les jours elles se convainquent, pour recommencer, qu'elles vont tomber sur quelqu'un qui va les aimer ». Édith explique ainsi sa « dépendance » à la prostitution, faite de temps d'arrêts et de rechutes : « On s'est fait des amis. C'est dur de les abandonner… Puis qui sait ce qui peut arriver ». Ainsi se devine en elle une Pretty Woman en puissance, qui se berce d'illusions et chasse l'amour en donnant le sien. Il en est pour qui le conte de fée s'écrit presque ; un client qui tombe amoureux, un mariage qui se célèbre ; mais la même vie qui continue.
12h. Trottoir désert


En faisant le tour du bloc, Edith lance des regards en coin aux hommes qu'elle reconnait comme des habitués. Ça ne mord pas. Elle croise quelque copines, peu nombreuses. « Notre métier est en déclin, nous sommes de moins en moins », confie-t-elle. Elle tâtonne son téléphone, espérant que son « rendez-vous » avec un habitué se confirme. Elle n'aura pas de nouvelles.
13h. « Les cafés nous mettent dehors »
« Il y a beaucoup de cafés qui n'acceptent pas les prostituées. On est vite repérées après avoir fait le tour du bloc quelque fois…. Ça me fait sourire. On ne le prend ni mal ni bien, c'est comme ça ». C'est donc toujours dans le même bistrot, plus tolérant, « Le Bridge », qu'Edith déballe son pique-nique. Il y a du tout-venant. Mais à bien y regarder, il y a des « clients », des hommes qui offrent les consommations à ces filles qu'ils respectent, voire séduisent, après les avoir achetées.


14h. Et le plaisir là-dedans ?


De retour sur le pavé, c'est le même chômage. Edith s'épanche alors sur la question du plaisir. Est-il possible de prendre son pied dans le cadre du sexe tarifé ? « C'est en tout cas une volonté fréquente des clients. Pour nous, il est impossible de jouir à chaque fois. Il faut alors simuler pour satisfaire leur égo. C'est mieux ainsi. En fait, l'inverse me met mal à l'aise : je n'aime pas avoir de plaisir en dehors d'une relation amoureuse. C'est le boulot ici ».
Le low cost, là aussi
Elles vendent leurs corps, mais elles ont exactement le même discours que toutes les autres commerçantes. « Les belles, les moches, les bonnes, les grosses, les jeunes, les vieilles », toutes logées à la même nouvelle enseigne, se plaint Thérèse, après une journée « pour rien ». « Il n'a plus de travail », râle la Polonaise de 59 ans. Plus loin, cela fait presque quatre heures que des jeunes femmes de l'Est attendent en vain. « Le quartier se meurt », conclut Edith en rôdant dans le froid.
Il y a eu trop de descentes de police, trop d'amendes distribuées aux clients ; les fiches estampillées « prostitution » envoyées à domicile ont su refroidir les plus échauffés, souvent mariés.
Sur le trottoir, se joue alors une concurrence féroce entre les filles et un marchandage périlleux qui profite aux seuls clients. Il y a quelques années, il fallait compter 50 euros pour une passe, et plus au fur et à mesure des spécificités de la demande. Aujourd'hui, pour 50 euros, les filles font tout. Certaines font chuter les prix à 35, voire 25 euros, et toutes ainsi perdent la main sur le négoce. Elles entrent dans l'engrenage du risque, la passe ira à celle qui renoncera au préservatif. Il y a de cela cinq bonnes années encore, faire le tapin revenait à empocher 100 à 150 euros « nets » par jour. Il y en a même qui ont pu payer partie de leur maison avec l'argent de la prostitution. En ces temps « de crise », comme elles disent, elles s'en retournent souvent chez elles sans le sous, avec un rhume et des idées plus noires encore.
Faut-il prendre la peine d'annuler une pute ?
C'est dire si le plus vieux métier du monde est mal en point. La dernière cohorte des règlements de confinement semblent venir à bout de la prostitution de rue à Bruxelles. À la gare du midi, elle n'existe plus qu'à l'état résiduaire. Sur l'avenue Louise, elle n'a plus rien de luxueux ; dans le quartier de la gare du nord, elle est tolérée sur deux longueurs de rue, où les filles s'ennuient du « chômage ». Les prostituées des vitrines de la rue d'Aarschot et des « carrées » de Schaerbeek et Saint-Josse vivotent mieux, mais celles-là ont des papiers en règle…
Sans s'éteindre, la demande en sexe tarifé s'est transformée. Elle a quitté le pavé pour migrer sur Internet, moins visible, moins dérangeante, mais sans plus de garantie de sécurité pour les filles. Les prostituées de rue ont saisi le mouvement ; elles s'assurent comme seuls revenus réguliers des clients fixes qui les appellent pour booker une passe. Édith sacrifie facilement quatre heures de son temps pour gagner Bruxelles en train et retrouver un client, qui parfois, lui, n'est finalement pas au rendez-vous. Faut-il prendre la peine d'annuler une pute ?
« Dans la rue, je suis mon propre patron »
Alors pourquoi continuer, si ce n'est plus même payant ? « Parce qu'on ne sait rien faire d'autre », souffle l'une, impuissante et fataliste. « Parce qu'on n'a pas de papiers pour avoir un « vrai » travail », se justifie une autre. « Parce qu'un autre travail n'est pas mieux », assène Martha. « J'ai déjà travaillé dans des bars et des cafés. C'est aussi de l'exploitation. La seule différence dans la rue, c'est que je suis mon propre patron ».
Pour entendre une forme de résilience, il faut écouter les travailleurs sociaux. « On y croit pour elles », promet Soline de l' « Entre 2 », « mais qu'est-ce qu'il est épuisant de se mobiliser sans parvenir à les mobiliser ; de mettre des choses en place qui n'aboutissent pas ; de lancer des démarches qu'elles ne prendront pas la peine de faire aboutir. J'ai l'impression de faire la même chose depuis des années, un peu pour rien. Mais je continuerai ».


15h. Entre 2
Pour se réchauffer le corps et le moral, Edith passe toujours une heure à « Entre 2». Plantée boulevard d'Anvers, l'asbl subsidiée par la Cocof accueille les prostituées tous les jours, pour tout et pour rien. « On est juste là », explique Alexandra, travailleuse sociale, « sans obligation, pour parler, boire un café. Quand elles nous le demandent, on est aussi plus concrètement présentes pour les accompagner dans les démarches sociales (demande de régularisation, rédiger un cv, appeler le CPAS…). Tous les matins, on est aussi sur le terrain, pour leur distribuer des préservatifs, des gels, des brochures en sept langues. Et enfin, deux jours par semaine, on leur offre la possibilité de rencontrer un médecin, gratuitement ».


16h. « C'est une drogue »


Une journée de tapin pour rien. Edith s'engage, bredouille, sur le trajet du retour. Elle reviendra. Pourtant, elle n'en a plus un réel besoin financier, depuis qu'elle est pensionnée… Mais « c'est une drogue », tente-t-elle d'expliquer. « Il y a une sorte d'adrénaline. On est accrochée au milieu, c'est difficile de se « déshabituer ». En fait, je peine à me l'expliquer moi-même… La vie d'artiste peut-être ! Car il faut être sacrément bonne actrice… ».
Reportage : Céline Rase
Vidéo : Julien Rensonnet
Webmaster: Cédric Dussart